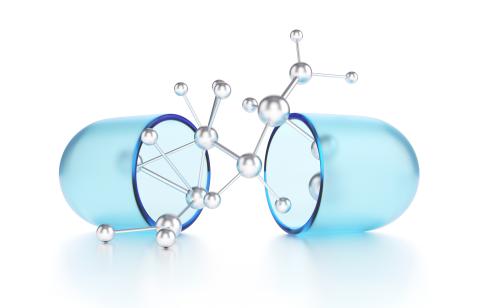
Frédéric Taran : la chimie de la cellule vivante
Frédéric Taran est directeur de recherche au CEA et chef du service de chimie bioorganique et de marquage (SCBM) au sein du département Médicaments et technologiques pour la santé (MTS – Univ. Paris-Saclay, CEA, INRAE). À l’interface de la chimie et de la biologie, sa spécialité est la chimie bioorthogonale et ses applications dans le domaine de la santé, en particulier pour le diagnostic et le traitement de cancers. Coordonnant plusieurs projets de recherche aux niveaux national et international, le chercheur est un acteur majeur de cette communauté, distingué en 2023 par le Prix Seqens de l’Académie des sciences.
« Mon cœur de métier, c’est la chimie organique, confie Frédéric Taran. J’ai toujours été fasciné par le monde vivant, poursuivant le rêve de reproduire un jour les millions de réactions chimiques simultanées qui caractérisent le fonctionnement d’une cellule. » Le chercheur évolue depuis longtemps au service de chimie organique et de marquage (SCBM), un des trois services du département Médicaments et technologiques pour la santé (MTS – Univ. Paris-Saclay, CEA, INRAE) qui regroupe près de 70 collaborateurs et collaboratrices. Il y soutient sa thèse en 1996 et y est recruté en 1998, dès son retour des États-Unis et de son post-doctorat à l'université A&M du Texas. « J’ai travaillé auprès de Sir Derek Barton, chimiste britannique nobelisé en 1969. Avec Charles Mioskowski, mon directeur de thèse, il fait partie des personnes qui ont beaucoup compté pour moi. » Quelques années plus tard, Frédéric Taran prend la direction du Laboratoire de marquage au carbone 14 puis celle du SCBM.
Une chimie applicable au vivant
Au début des années 2000, les chercheurs américain Karl Barry Sharpless et danois Morten Meldal inventent une nouvelle chimie, baptisée « click » en référence à son principe d’accrocher deux « objets » (molécules, protéines, nanoparticules…) entre eux. Le concept n’est pas nouveau en chimie organique. Ce qui l’est, c’est de rendre ce phénomène pérenne et efficace dans tous les solvants, quelle que soit la complexité structurale des objets. Quelques années plus tard, une chercheuse américaine, Carolyn Bertozzi, parvient à appliquer la chimie click aux organismes vivants. En 2022, ces trois chimistes obtiennent le prix Nobel de chimie pour le développement de cette « chimie click » et de la chimie dite bioorthogonale. « On l’appelle chimie bioorthogonale en référence à son fonctionnement orthogonal à la biologie. Autrement dit, il faut créer les conditions d’association entre des fonctions chimiques artificielles dans des milieux naturels », détaille Frédéric Taran. Ébloui par cette découverte, le chercheur décide d’emblée d’appliquer cette nouvelle chimie à ses propres recherches. Son équipe et lui travaillent à l’époque sur le criblage haut débit pour des applications thérapeutiques, dont le principe est de multiplier les manipulations en les analysant simultanément pour accroitre la probabilité de découvrir de nouvelles molécules bioactives.
Une chimie artificielle dans un milieu naturel
« La chimie click reste un domaine assez neuf, expose le chercheur. Ses outils sont nés dans les années 2000, mais les applications dans le domaine de la santé émergent depuis peu. » Pour connecter in vivo deux « objets », il est nécessaire de surmonter un nombre d’obstacles impressionnant. Il faut éviter que le milieu naturel ne dégrade, métabolise ou élimine les réactifs qui, de plus, doivent être biocompatibles. En 2013, un premier succès est au rendez-vous : Frédéric Taran et ses collaborateurs et collaboratrices découvrent une nouvelle réaction click. Quatre ans plus tard, ils et elles parviennent à rendre le système véritablement bioorthogonal. Il leur faut deux ans de plus pour le rendre extrêmement rapide. En 2019, l’équipe réussit sa première expérience de click in vivo, ce qui vaut au chercheur de recevoir le prix Pierre Fabre de la société de chimie thérapeutique.
Des applications en thérapie ciblée
Les recherches de l’équipe de Frédéric Taran sont actuellement soutenues par différents programmes. « La découverte de la possibilité de faire une chimie artificielle dans un organisme vivant a ouvert des perspectives d’applications diagnostiques et thérapeutiques incroyables, en particulier en cancérologie. Par exemple, lorsqu’un ou une patiente est soumise à un examen d’imagerie par ImmunoPET (le petscan nouvelle génération), on lui injecte un anticorps. Au lieu d’être radiomarqué comme ce qui se fait actuellement (et pour éviter la persistance dans le corps de la radioactivité), on place dessus une petite fonction de la chimie click. L’anticorps se fixe sur la tumeur au bout deux ou trois jours. Puis on introduit dans le sang de la personne une petite molécule complémentaire, laquelle est cette fois radiomarquée avec du fluor 18. Il suffit de quelques minutes pour que la molécule diffuse partout dans l’organisme et, si tout va bien, se fixe par click sur la tumeur, qui sera alors très précisément repérée. »
Clicker ou couper
En chimie bioorthogonale, on peut soit lier deux objets soit couper une molécule en deux à l'intérieur d'un corps humain, avec, à la clef, de très nombreuses applications en santé également. En 2019, Frédéric Taran et Sébastien Papot, professeur à l'université de Poitiers, sont les premiers à réussir à faire « exploser » une nanoparticule par chimie bioorthogonale dans le milieu vivant. Dans ce cas, on injecte non pas un anticorps, mais une nanoparticule qui contient un médicament. Dotée d’un des outils de chimie click, elle s’accroche dans la tumeur puis se coupe au contact d’une seconde molécule injectée in vivo. Le médicament prisonnier se libère alors dans l’organisme. « Le challenge nous paraissait inaccessible, se souvient le chercheur. Le moment où les résultats de l’expérience confirment notre réussite demeure l’un des plus extraordinaires de ma carrière, d’autant plus qu’il a été partagé avec un très bon ami. »
L’imaginaire chimique au service de la santé humaine
Pour le moment, les applications se développent plutôt dans le secteur de l'imagerie médicale, moins dans les thérapies émergentes, comme les antidotes et les épurateurs auxquels Frédéric Taran s’intéresse actuellement. « L’idée est d’éliminer très rapidement par les voies naturelles un médicament qui persiste dans le corps, en cas de surdosage par exemple. On ferait des choses plus vite si les industriels s’y intéressaient davantage », confie le chercheur. Lui-même a le pied à l’étrier à son doctorant en 2013 pour fonder, en collaboration avec un chercheur de l’université de Strasbourg, SYNDIVIA, une startup de biotechnologie qui exploite leur découverte pour améliorer la performance des médicaments anticancéreux.
Aujourd’hui, Frédéric Taran continue d’accueillir au SCBM de jeunes chimistes de nombreux pays, auxquels il transmet sa passion, intacte, des molécules chimiques et du développement des outils de chimie bioorthogonale au service de la santé humaine. « Outre de nouveaux outils de diagnostic pour les thérapies ciblées, j’imagine, d’ici une dizaine d’années, mettre au point des agents de clairance génériques, c’est-à-dire des sortes d’épurateurs fonctionnant comme des antidotes dirigés vers tout ce qu’on veut », conclut le chercheur.

