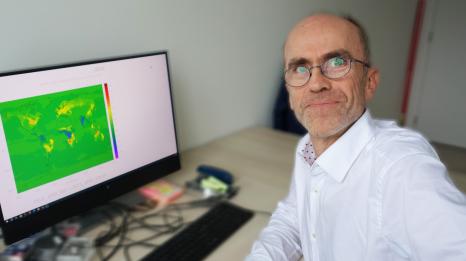Fréderic Chevallier : l’inversion atmosphérique sens dessus dessous
Frédéric Chevallier est ingénieur-chercheur au CEA et responsable de l’équipe Modélisation inverse pour les mesures atmosphériques et satellitaires (SATINV) au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE – Univ. Paris-Saclay/CNRS/CEA/UVSQ). Pionnier de l’introduction de l’intelligence artificielle dans les modèles de prévision météorologique, ainsi que de la cartographie des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le globe, il poursuit aujourd’hui le développement de son modèle d’inversion atmosphérique.
Tout commence à Rennes où dans sa jeunesse Fréderic Chevallier se passionne pour la lecture du magazine Sciences et Vie, en particulier les articles sur l’aérospatial, qu’il apprend par cœur. Plus tard, il s’enthousiasme pour un stage de master 2 au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD – CNRS/École polytechnique/ENS -PSL/Sorbonne Univ.), à Palaiseau. Le stage évolue ensuite vers une thèse, dont le sujet porte sur l'accélération d'un modèle de transfert radiatif utilisé en météorologie et en climatologie. Le doctorant remplace un modèle physique complexe par un ensemble de réseaux de neurones artificiels que l’équipe Analyse du rayonnement atmosphérique du LMD a choisi, dans les années 90, d’appliquer à différentes applications autour du rayonnement atmosphérique. « On parlerait aujourd’hui d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Je travaillais donc sur ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning », se souvient Frédéric Chevallier, qui soutient sa thèse en 1998. « À l’époque, les modélisateurs de l’atmosphère observaient mes travaux avec circonspection. Aujourd’hui, l’utilisation de l’IA fait la Une de la presse et les centres météorologiques recrutent de nombreux spécialistes de cette nouvelle discipline. » Ses premiers travaux l’amènent justement au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), à Reading en Grande-Bretagne, où le chercheur y reste six années.
De la prévision météorologique à la surveillance de l’environnement
Pour passer le cap de la prédiction météo au-delà de quelques heures à l’échelle d’un pays, il faut en effet unir les forces des pays voisins, « car la météo du jour en France métropolitaine dépend de celle de la veille sur l'océan Atlantique, laquelle influence aussi celle du jour en Espagne ou en Irlande », fait remarquer Frédéric Chevallier. C'est ainsi que naît le CEPMMT. Le centre européen, dont la mission originelle est la prévision météo à l'échéance de quelques jours sur l'ensemble du globe, délègue aux centres nationaux la prévision à une échéance plus courte sur leur territoire. Depuis sa création, le CEPMMT s'est beaucoup développé, se positionnant par exemple sur la modélisation du système Terre et la surveillance de l'environnement au travers du programme Copernicus, et ouvrant une antenne à Bologne (Italie) et une autre à Bonn (Allemagne). En 2003, Frédéric Chevallier rejoint le LSCE avec justement pour mission d'aider le CEA à participer au programme Copernicus. En 2009, il obtient son Habilitation à diriger des recherches (HDR).
L’inversion atmosphérique
Frédéric Chevallier figure parmi les pionniers de l’inversion atmosphérique pour cartographier les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre (GES). « Les concentrations de GES observées dans l’atmosphère proviennent d’une infinité de scénarios d'émissions et d'absorptions sur le globe. Pour les trier et estimer le scénario le plus probable, nous sommes obligés d'utiliser des méthodes statistiques. L’approche inverse consiste à remonter depuis les sorties des modèles de transport atmosphérique, c’est-à-dire les concentrations de GES qu’on observe dans l’atmosphère, vers leurs entrées, c’est-à-dire les émissions et absorptions de ces gaz. » Le chercheur s’appuie sur un théorème attribué par erreur au révérend Thomas Bayes, introduit en réalité par Pierre-Simon Laplace en 1774. Frédéric Chevallier est aussi l’un des premiers à s’attaquer aux problèmes d’inversion de grande dimension pour les GES en s’inspirant des techniques utilisées en prévision météorologique et qu’il a apprises au CEPMMT. Ces techniques lui permettent de travailler sur les vastes flux de données générées par les satellites pour cartographier les émissions et absorptions avec une finesse de détails inédite.
Modéliser les données fournies par les satellites
Parmi les temps forts de sa carrière, les lancements de deux satellites américains marquent Frédéric Chevallier. Il est présent devant la base de la force spatiale de Vandenberg en Californie en 2009 pour le lancement raté d'OCO, premier instrument de la NASA dédié à la mesure du CO2, puis en 2014 pour celui, réussi cette fois, du deuxième exemplaire. Partager avec l’équipe scientifique de cette mission stratégique le succès autant que l’échec est une expérience humaine rare. Aujourd’hui, le chercheur participe aux missions de plusieurs satellites français et européens. « MicroCarb sera lancé par le CNES au début de l'été 2025. Plus compact, plus léger et moins coûteux que OCO-2, il observera les colonnes de dioxyde de carbone sur le globe avec l'ambition de faire aussi bien que l'instrument de la NASA. De plus, il analysera une bande spectrale supplémentaire, ce qui réduira les biais du produit final. » L'Europe mettra aussi en orbite en 2027 et 2028 une constellation de trois satellites, destinés à imager les panaches de CO2 sur tout le globe.
Des données de plus en plus fines
En 2022, Frédéric Chevallier découvre comment accélérer son code de modélisation du transport atmosphérique. Pas d’apprentissage machine cette fois : il a l’idée d’utiliser des cartes graphiques. « En deux ans, les processeurs graphiques ont révolutionné mon travail. Ils m’ont permis d'augmenter considérablement mon modèle, passant de 300 km à 90 km de résolution sur tout le globe. Concernant la résolution de 22 km, sur laquelle on commence à travailler, on obtient plusieurs pixels sur une distance comme celle qui sépare Rennes de Saint-Malo, alors qu’auparavant un seul pixel englobait l’ensemble de la Bretagne ! Cette finesse a un impact direct sur les capacités des systèmes d’inversion et leurs diverses applications, et donc les utilisateurs et utilisatrices potentielles. » Aujourd’hui, Frédéric Chevallier continue à travailler à l'amélioration de la résolution du modèle, notamment avec des étudiantes et étudiants de CentraleSupélec. Les données des versions consolidées sont disponibles gratuitement sur le portail Copernicus du CEPMMT.
Le programme Copernicus
« Il existe un intérêt sociétal extrêmement fort pour l'inversion atmosphérique », affirme Frédéric Chevallier. Cela constitue une source de motivation pour son équipe, composée d'une trentaine de personnes, et un facteur d’attractivité de talents en France comme à l’international. Le programme Copernicus contribue d’ailleurs en partie au financement de l’équipe. Le CEPMMT coordonne la partie « atmosphère » de Copernicus et découpe le programme en « services » élémentaires, chacun faisant l’objet d’appels d’offres pour l’ouverture de contrats de sous-traitance de deux à trois ans. Frédéric Chevallier est coordinateur du service dédié à l'inversion atmosphérique depuis l’origine du programme, il y a dix ans, tout en assurant la responsabilité de la chaîne correspondante de production des données pour le CO2.
« Mon travail est composé à 90 % d'ingénierie, avec le développement d'algorithmes et le traitement de données sur différents calculateurs, et 10 % de recherche. En tant que directeur de recherche, je définis des orientations de recherche que je mets en œuvre au sein d’un collectif. Mais celles-ci reposent sur une ingénierie de pointe, pour rendre possible ce qui ne l’était pas jusque-là », conclut Frédéric Chevallier, qui aime concilier ces deux facettes, pour lui aussi exaltantes l’une que l’autre.