
Mieux comprendre les microclimats urbains : un défi pour faire face au changement climatique dans les villes
Cet article est issu de L'Édition n°27.
Les villes constituent des environnements complexes dont les climats méritent une attention particulière. À la fois causes et victimes du changement climatique, elles font aujourd’hui face à de nombreux défis pour préparer l’avenir. Afin de les y aider, des chercheurs et chercheuses de l’Université Paris-Saclay travaillent à mieux comprendre les microclimats urbains, les dynamiques qui les animent et les paramètres qui les influencent tels que la végétalisation et la pollution de l’air.
Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville, c’est-à-dire dans un lieu à forte densité humaine mais aussi à forte densité de bâti. Ce chiffre va d’ailleurs continuer à augmenter dans les prochaines décennies et le nombre de citadins devrait pratiquement doubler d’ici 2050, avec sept personnes sur dix dans le monde vivant alors en milieu urbain.
Si les zones urbaines ont une incidence déterminante sur la production de gaz à effet de serre (GES) – elles représentent 75 % des émissions globales responsables du changement climatique -, elles sont aussi particulièrement sensibles aux effets de ce changement. Du fait des activités anthropiques mais aussi de la nature du revêtement des surfaces urbaines et des bâtiments, elles sont le lieu de fortes pollutions et de vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, qui ont un impact important sur la santé des populations urbaines.
Les vagues de chaleurs, comme celles de 2003 ou de 2022 en France, sont associées à une nette surmortalité, en particulier chez les populations les plus fragiles et exposées. La pollution de l’air par les particules fines est, elle, responsable de 40 000 décès par an en France. Ces enjeux de santé publique rendent essentielle une meilleure compréhension des phénomènes atmosphériques dans les villes, d’autant plus dans un tel contexte de changement climatique. Il faut en effet parvenir à adapter les milieux urbains pour les rendre plus habitables dans un futur qui s’annonce irrémédiablement plus chaud.
Les villes : des microclimats complexes
Pour comprendre le microclimat des villes, il faut d’abord appréhender ce que ce milieu a d’original. Sophie Bastin, chercheuse au Laboratoire atmosphère et observations spatiales (Latmos - Univ.Paris-Saclay/CNRS/UVSQ/SorbonneUniv.) explique : « Le milieu urbain est particulier par l’imperméabilité de ses sols. L’eau y reste moins longtemps, ce qui modifie le bilan énergétique. » Ainsi, l’énergie reçue par la ville (sous forme de rayonnements solaires, par exemple) est renvoyée uniquement sous forme de chaleur, alors que dans un milieu où la végétation prédomine, l’énergie est également utilisée pour faire évaporer l’eau stockée. Elle est alors renvoyée sous forme de chaleur et d’humidité, ce qui limite l’accumulation de chaleur telle qu’observée en ville. « Les bâtiments, même s’ils ont un effet d’ombrage,ont surtout une capacité thermique (capacité à absorber la chaleur) et une conductivité thermique (capacité à transmettre la chaleur) très élevées. Ils emmagasinent la chaleur qu’ils restituen plus lentement, notamment la nuit », continue la chercheuse.
Les bâtiments représentent donc une source de chaleur nocturne qui n’existe pas en milieu naturel. De nombreuses autres sources anthropiques de chaleur sont également présentes en ville, comme le chauffage ou la climatisation. Tous ces facteurs expliquent la présence d’un îlot de chaleur sur les centres urbains, se traduisant par une nette différence de température entre la ville et ses alentours, particulièrement la nuit. À Paris, le centre-ville affiche ainsi une température moyenne 2,5°C plus élevée que celle des zones rurales alentour. Certaines nuits, la différence peut même atteindre 8 à 10°C. Cet effet de l’urbanisation qu’est l’îlot de chaleur revêt une importance cruciale dans le contexte actuel du changement climatique qui rend les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, et encore plus difficilement supportables dans les zones urbaines. C’est notamment le cas la nuit, période durant laquelle les refuges de fraîcheur (centres climatisés,parcs urbains...) sont généralement fermés au public, augmentant la vulnérabilité des populations déjà les plus fragilisées.
Étudier le climat des villes : entre mesures et modélisations
L’étude de ces microclimats urbains nécessite de combiner des observations réelles et des modélisations physiques. Pour étudier le climat en région Île-de-France, le Latmos dispose des données collectées par le Site instrumental de recherche par télédétection active (Sirta) situé près de l’École polytechnique, à Palaiseau (Essonne). Cet observatoire collecte depuis plus de vingt ans des profils verticaux de températures, de nuages ou de précipitations, à l’aide notamment de radars ou de télédétection par laser (lidar).
En complément, les chercheurs et chercheuses utilisent les données provenant du radar de Météo-France situé à Trappes (Yvelines). Sophie Bastin précise : « Les instruments du Sirta regardent vers le haut, là où le radar de Trappes scanne l’horizon et produit des données avec une résolution spatiale de quelques kilomètres. » Ces jeux de données sont aussi enrichis par celles provenant du réseau de stations Météo-France, dont quelques-unes sont situées en milieu urbain (dans le parc Montsouris à Paris notamment), et par des campagnes de mesures complémentaires.
En plus de ces mesures, de nouveaux modèles climatiques commencent à voir le jour pour donner la possibilité de travailler sur des échelles de temps longues, avec de meilleures résolutions spatiales. « On a développé des modèles de climat régionaux qui nous permettent d’avoir des résolutions spatiales beaucoup plus fines que les modèles globaux utilisés auparavant », explique la météorologiste. Ces modèles ont la particularité d’intégrer des données satellites afin de prendre en compte la spécificité de chaque ville : la densité de son bâti, la hauteur de ses bâtiments, la largeur des rues, les capacité et conductivité thermiques des bâtiments. Un modèle de ville (ou schéma urbain) est intégré dans le modèle climatique afin de représenter au mieux les effets de la ville, son interaction avec l’environnement et sa dynamique atmosphérique. On différencie ainsi une zone urbaine très dense comme le centre de Paris des zones pavillonnaires. Bien que ces modèles climatiques ne simulent pas la température à l'échelle d'une rue, en utilisant les bons paramètres, ils reproduisent correctement la variabilité de l'intensité de l'îlot de chaleur urbain.
Cette complexification des modèles se fait dans le cadre du projet international CORDEX, coordonné par le World Climate Research Project, et auquel prennent part Sophie Bastin et son équipe. « L’exercice consiste à déterminer quel degré de complexité est nécessaire pour correctement modéliser le cycle de l’eau de la ville et ses alentours, tout en représentant les extrêmes, comme les vagues de chaleur, à l’échelle climatique. » Pour répondre à cette question, les scientifiques de différents instituts internationaux font tourner leur modèle avec des schémas plus ou moins complexes et confrontent ensuite les sorties aux données mesurées. Si le modèle est correct, il peut être utilisé pour aider les villes à s’adapter au changement climatique. Dans un tel modèle, il est possible de faire varier la hauteur des bâtiments, leur capacité/conductivité thermique, d’ajouter des parcs, de désimperméabiliser les sols, de construire ou déconstruire une zone de la ville, et de suivre les effets que ces mesures auront sur les précipitations ou les vagues de chaleur, et ce, dans un climat global qui se réchauffe.
InteGREEN : appréhender les avantages et inconvénients de la végétation en ville
Végétaliser davantage les villes est un bon moyen d’adapter ces milieux au changement climatique et de les rendre plus habitables. Les végétaux améliorent la santé et le bien-être des habitants tout en réduisant localement l’îlot de chaleur urbain et les risques d’inondation. Pourtant, cette végétation peut être à l’origine de problèmes de répartition des ressources hydriques et avoir un impact non négligeable sur la qualité de l’air.
Le projet InteGREEN, lancé en avril 2025 dans le cadre du PEPR (Programmes et équipements prioritaires de recherche) Villes durables, a pour objectif d’évaluer de la manière la plus complète possible (du point de vue du climat, des ressources hydriques, de la qualité de l’air, des aspect sociologiques, etc.) les services urbains fournis par les végétaux, en tenant compte aussi bien de leurs bienfaits que de leurs effets indésirables. Cette étude interdisciplinaire vise ainsi à aider les villes dans la planification de leurs espaces verts, en leur conseillant par exemple quelles espèces planter et où les installer. Impliqués dans le projet, Sophie Bastin et son équipe vont utiliser leurs modèles climatiques pour appréhender l’impact de la végétation urbaine sur le cycle de l’eau (température, nuages, précipitations, ruissellement).
Une autre équipe de l’Université Paris-Saclay participe également au projet : celle de Valérie Gros, chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE - Univ. Paris-Saclay/UVSQ/CNRS/CEA). Spécialisée en chimie atmosphérique expérimentale, cette équipe opère la station du site de l’École polytechnique, comprise dans le Sirta et dont les scientifiques se servent pour mesurer les concentrations de certains polluants in situ. Si Valérie Gros et son équipe s’intéressent aux composés « classiques » comme le benzène, d’origine presque exclusivement anthropique, elles étudient également des composés organiques volatiles (COV) générés par la végétation, comme les terpènes qu donnent aux pins leur odeur particulière. Alors que ces composés ne posent aucun problème en milieu naturel, comme en forêt, la situation est différente en milieu urbain où ils rencontrent des polluants d’origine anthropique tels que l’oxyde d’azote émis par les voitures. « Les COV sont des composés très réactifs qui, par réaction chimique, se transforment dans l’atmosphère et donnent lieu à des polluants secondaires comme l’ozone ou des aérosols organiques », explique Valérie Gros qui, dans le cadre du projet InteGREEN, cherche avec son équipe à déterminer quelles espèces d’arbre sont les moins productrices de COV réactifs et dans quelles conditions.
Mené en étroite collaboration avec des instances décisionnaires comme la ville de Paris et la Métropole du Grand Paris, le projet implique également des institutions comme Eau de Paris ou AirParif qui, respectivement, gère l’eau et surveille l’air de la ville. Toutes les parties prenantes espèrent que des applications directes naissent rapidement des conclusions scientifiques découlant du projet.
Les émissions de COV par les arbres, une source de polluants secondaires
Valérie Gros et son équipe ont par le passé déjà travaillé sur la question des COV produits par les plantes. Dans le cadre du projet STREET (Impact of stress on urbantrees and on city air quality), elles ont réalisé des mesures à Vitry-sur-Seine puis à Paris durant les périodes de printemps-été 2020 à 2022. L’objectif était de quantifier l’impact de l’arbre urbain sur la qualité de l’air. « Nous avons tout d’abord mesuré l’émission de COV de quatorze petits platanes en pot. Nous avons ensuite fait des mesures en conditions plus réelles, en prenant pour objet d’étude un petit parc proche de l’Hôtel de ville de Paris, que nous avons choisi pour sa variété d’espèces végétales ainsi que pour la proximité des quais de Seine, une source importante de polluants anthropiques », précise la chercheuse. Les différentes espèces d’arbres émettant diverses familles de COV, dans des quantités disparates, étudier un parc avec une variété d’arbres sert à identifier quelles espèces sont les moins susceptibles d’être une source de polluants secondaires, et donc à sélectionner les espèces à planter en ville.
Pour mesurer les émissions de COV par les arbres du parc, les scientifiques du LSCE ont conçu une chambre dans laquelle elles et ils ont enfermé une des branches d’arbre, puis mesuré tout ce qui entrait et sortait de la chambre. Après avoir collecté ces données et analysé la différence entre les entrées et sorties, les scientifiques ont coupé la branche afin de déterminer sa masse et de rapporter la quantité d’émission de COV à la biomasse correspondante. « C’est grâce à toutes ces mesures qu’on a calculé le facteur d’émission de la branche », souligne Valérie Gros.
L’émission de COV étant favorisée par les rayonnements solaires et la chaleur, l’équipe a attendu l’été pour réaliser son étude qui a abouti à l’observation de niveaux de COV très élevés, et donc à une plus grande production d’aérosols organiques. Les mesures n’ayant été effectuées que sur un mois et très localement, l’équipe de STREET les a ensuite intégrées dans un modèle informatique afin de généraliser les résultats et de les rendre plus représentatifs dans le temps et l’espace. Ce modèle a aussi intégré des mesures faites par l’observatoire du LSCE, localisé sur le plateau de Saclay, et servant de bruit de fond régional. « Sur le plateau de Saclay, quand les vents viennent du sud-ouest, les niveaux de pollution de l’air sont très faibles car ils n’ont traversé que peu de zones urbanisées », précise Valérie Gros.
L’équipe est parvenue à quantifier l’impact des arbres sur la qualité de l’air à l’échelle de la ville. Elle a montré que, sur le cas d’étude de l’été 2022, les émissions de COV par les arbres induisent une augmentation de 5 à 10 % de la concentration de particules secondaires. Bien qu’intégrer le végétaux dans des modèles de qualité de l’air soit nécessaire, il est important de noter que les sources anthropiques de polluants dominent largement en ville. Et les arbres apportent par ailleurs de nombreux avantages, comme la réduction locale de l’îlot de chaleur urbain. Les études, comme celles réalisées dans le cadre du projet STREET et du projet InteGREEN, aident les villes à choisir quelles espèces végétales planter en tenant compte aussi de la pollution de l’air.
Les toits végétalisés, avantageux en été comme en hiver
Les arbres ne sont pas les seuls végétaux présents dans les villes. Les herbacées en sont d’autres, introduites notamment sous la forme de toits végétalisés. Ces derniers étant situés en hauteur, leur effet sur l’îlot de chaleur au niveau de la rue se révèle faible. Mais indirectement, ils améliorent l’efficience énergétique du bâtiment sur lequel ils se trouvent. « Si on améliore cette efficience énergétique, il y a moins de transfert de chaleur vers l’intérieur du bâtiment. On relargue moins de chaleur liée à l’utilisation de la climatisation et on diminue l’îlot de chaleur », explique Patrick Stella, maître de conférences à AgroParisTech et chercheur au laboratoire Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes (Ecosys - Univ. Paris-Saclay/AgroParisTech/INRAE). Si cet effet d’isolation thermique produit par les toits végétalisés est bien connu lors de conditions estivales, comprendre leur effet en hiver est tout aussi important, le risque étant qu’ils refroidissent le bâtiment.
Patrick Stella s’intéresse à la question en étudiant les toits de l’ancien bâtiment d’AgroParisTech, situé rue Claude Bernard, à Paris. « Il s’agit d’un vieil immeuble haussmannien mal isolé sur lequel étaient présentes deux toitures végétalisées : une extensive (une fine couche de sol agrémentée de façon éparse de sedums) et une semi-extensive (une pelouse sur une couche de sol plus épaisse) », décrit l’enseignant-chercheur. En parallèle, les scientifiques d’Ecosys utilisent une partie non végétalisée du toit comme référence. Ils mesurent sur chacune des parcelles la température, les transferts de chaleur à travers le toit, ainsi que les rayonnements. « Grâce à ces observations, nous avons montré que les toitures végétalisées rafraîchissent les bâtiments en été mais ne les refroidissent pas en hiver », signale Patrick Stella. Ajouter une couche de sol et de végétaux sur le toit d’un bâtiment mal isolé réduirait même ses pertes thermiques en hiver.
Mesurer les émissions de CO2 des villes pour mieux les réduire
S’il est important d’étudier le climat des villes pour mieux les adapter au changement climatique, il est également primordial de contrôler l’impact des zones urbaines sur le climat. C’est dans un tel but que deux équipes du LSCE participent à l’infrastructure européenne de surveillance des GES, ICOS (Integrated carbon observatory system) qui s’intéresse aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) des villes. Elles gèrent une quarantaine de points de mesure du CO2 répartis dans le Grand Paris, un réseau urbain d’une densité unique au monde. Parmi les instruments servant aux mesures, neuf sont de très haute précision. « Ils représentent la colonne vertébrale du réseau. Nous avons ensuite voulu augmenter la densité des points de mesure dans ce milieu urbain et avons pour cela ajouté des observatoires moins précis, mais plus nombreux », exposent Michel Ramonet et Olivier Laurent, tous deux chercheurs au LSCE et impliqués dans ICOS.
Ces instruments de mesure sont installés sur les toits de Paris, ce qui les éloigne de la circulation et favorise des mesures représentatives d’une zone plus grande. Les mesures de CO2, couplées à des modèles de transport atmosphérique, viennent valider ou préciser les inventaires statistiques. Il s’agit d’une méthode d’estimation des émissions de CO2 par addition de différentes sources connues. « Ce sont des recueils de données d’activités.Par exemple, on compte les voitures qui passent sur une route, on collecte les données d’utilisation d’énergie ou du chauffage », détaille Michel Ramonet. Les inventaires statistiques, réalisés par AirParif, sont confrontés aux mesures réelles afin de s’assurer qu’aucune source n’ait été oubliée ou sous-estimée. « Bien que les tendances soient conservées, les points de mesure sont toujours supérieurs aux inventaires statistiques. On pense donc que ces derniers sous-estiment les émissions », concluent les scientifiques.
Dans le cadre d’ICOS, les deux équipes du LSCE participent à un autre projet, ICOS Cities, dont le but est de mettre en place une méthodologie standardisée de mesures des GES dans les villes. Beaucoup de villes européennes visant la neutralité carbone d’ici 2050, il devient nécessaire d’évaluer de façon fiable leur taux de CO2 et de contrôler rapidement l’évolution de sémissions après la mise en place de mesures anti-pollution. En prenant pour exemples trois villes européennes de tailles différentes – Paris (France), Zurich(Suisse) et Munich (Allemagne) -, ICOS Cities entend aider les villes qui le souhaitent à s’équiper d’instruments de mesure harmonisés au niveau européen voire mondial. Les scientifiques ambitionnent également de leur fournir des recommandations sur les bonnes pratiques à suivre en matière de suivi des émissions de CO2.
À travers ces initiatives destinées à mieux comprendre les dynamiques des climats urbains, les scientifiques espèrent identifier des leviers d’action pour aider les villes à planifier des décisions urbanistiques offrant une meilleure adaptation au changement climatique et de meilleures conditions de vie pour leurs habitants. Avec l’espoir de construire des villes qui soient à la fois neutres en carbone et agréables à vivre.
Références :
- G. S. Langendijk et al. Towards better understanding the urban environment and its interactions with regional climate change - The WCRP CORDEX Flagship Pilot Study URB-RCC. Urban Climate, 2024, 58.
- L. Sangelantoni et al. Investigating the representation of heatwaves from an ensemble of km-scale regional climate simulations within CORDEX-FPS convection. Climate Dynamics, 2024, 62.
- A. Maison et al. Contrasting effects of urban trees on air quality: From the aerodynamic effects in streets to impacts of biogenic emissions in cities. Science of the Total Environment, 2024, 946.
- P. Stella et E. Personne, Effects of conventional, extensive and semi-intensive green roofs on building conductive heat fluxes and surface temperatures in winter in Paris, Building and Environment, 2021, 205.
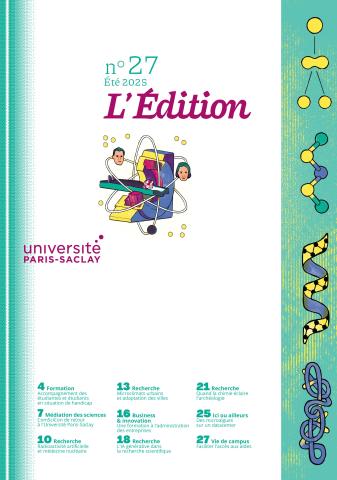
Cet article est issu de L'Édition n°27.
L'intégralité du journal est à découvrir ici en version numérique et sur Calaméo.
Pour découvrir d'autres articles et sujets, abonnez-vous au journal L'Édition et recevez les prochains numéros :


